Publié le 26 Février 2011

« On sera rentré aux vendanges ».
Le 1er août 1914, la France décrète la mobilisation générale. Voilà deux mois que l’Europe connait sa plus grave crise depuis la Guerre franco-prussienne de 1870-1871. A l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de la couronne impériale d’Autriche-Hongrie, à Sarajevo, et le refus signifié à l’Autriche par la Serbie de mener une enquête sur le territoire de cette dernière, s’ajoutent des antagonismes de plus de vingt ans entre les nations européennes sur des questions coloniales, des impérialismes et des nationalismes exacerbés. « Il est temps d’en finir » pourrait-on résumer.
De fait, la France rêve de revanche face au IIème Reich et de reprendre l’Alsace-Lorraine. L’Allemagne ne peut se résoudre à laisser la France et l’Angleterre se tailler « la part du lion » dans les colonies d’Afrique. L’Autriche-Hongrie cherche à étendre son influence vers les pays des Balkans, qui eux viennent à peine de prendre leur indépendance vis-à-vis d’un Empire ottoman qui agonise depuis des dizaines d’années. L’Italie a des visées sur sa frontière est avec l’Autriche, et la Russie songe à se créer un accès à la mer Méditerranée.
Deux alliances se font face : d’un côté, la Triple-Entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie ; de l’autre, la Triple-Alliance entre l’Italie, l’Empire germanique et l’Empire Austro-hongrois. Dans chaque camp, la défense militaire mutuelle est érigée en exergue dans les traités d’amitié.
L’Allemagne imagine l’envahissement de la France en passant par la Belgique. Le chemin est plus long, mais il a l’avantage d’éviter les massifs de l’est de la France. C’est le Plan Schlieffen, qui prévoit de battre notre pays en quelques semaines (la leçon sera-t-elle retenue en 1940 ?). Ce plan tient son nom du comte Alfred von Schlieffen, mort en 1913. Cet officier de l’Etat-major prussien, travaille à la manœuvre depuis 1894. Son idée est assez simple : prise entre la Russie et la France, deux pays de la Triple-Entente, l’Allemagne doit écraser au plus vite la France pour pouvoir ensuite détourner ses armées vers l’est et faire face à la puissante Russie. Et dans un pays aussi grand que l’Empire allemand, le temps de transport, d’acheminement des troupes, de l’ouest vers l’est est une donnée hautement stratégique. De plus, prises à l’ouest dans les Flandres, les forces anglo-françaises n’auront d’autres choix que d’affaiblir les garnisons des Vosges et de l’Alsace. Dans un second temps, une offensive sur ce secteur permettra de faire replier les Français jusqu’en Suisse !
Pour sa part, la France décide, dans le Plan XVII, de respecter la neutralité belge et d’attaquer son voisin en passant par la Lorraine. « Tout ceci n’est qu’une formalité. Aux vendanges nous serons rentrés » entend-on dans les trains qui transportent les régiments de toute la France vers les frontières de l’est.
La bataille des Frontières.
Chacun des belligérants applique son plan. A la différence, que les Français sont surpris par l’attaque allemande sur la Belgique, quand les Allemands résistent bien sur leurs frontières face à nos offensives en Lorraine et en Alsace. Bientôt, les armées alliées (françaises, belges et le contingent du Commonwealth installé en France) sont défaites sur toute la ligne de front. A Charleroi, dans les Flandres, deux-cent-cinquante-mille soldats français sont mis hors de combat en quelques jours ! Il s’agit maintenant pour les Alliés de retraiter vers le sud, sur la Marne, de reprendre des forces, si possible, pour pouvoir envisager de contre-attaquer. Le général en chef de l’Armée française, Joseph Joffre, l’explique aux ministres de la Guerre, qui se succèdent en ce mois d’août 1914 : Adolphe Messimy puis Alexandre Millerand.
Avec des taxis parisiens en guise de véhicules.
Le plan Schlieffen prévoyait d’envelopper Paris par l’ouest mais le général allemand Von Klück infléchit son offensive par l’est, pensant encercler les cinq armées étalées des Vosges à la Marne. Il ne fait pas attention aux Ière et IIème armées françaises (général Dubail et général Curières de Castelnau) qui sont restées stationnées en Lorraine et qui vont être le pivot de la contre-offensive française. Concentrée le long de la Marne, notre VIeme armée commandée par le général Maunoury, et créée par Joffre pour l’occasion, engage les Allemands le 5 septembre 1914, et soutient les combats jusqu’au 9, grâce, entre autres, à l’envoi d’urgence de dix-mille hommes de la garnison de Paris (commandée par le général Gallieni), dont une partie sera transportée par les célèbres taxis parisiens que l’on appellera « Les Taxis de la Marne ».
Au centre du dispositif français, Joffre nomme le général Foch à la tête d’une nouvelle IXème armée, chargée d’éviter toute brèche dans la région des marais de Saint-Gond (ouest du département de la Marne). Du 6 au 8 septembre, les Alliés ne réussissent pas à remporter une victoire décisive. Le 7, le Corps expéditionnaire britannique force le passage du grand Morin, rivière du nord de la Seine-et-Marne, puis le lendemain, franchit le petit Morin et arrive aux bords de la Marne. Au même moment, la cavalerie française de Franchet d’Esperey traverse aussi le petit Morin, alors que Foch doit reculer sur ses positions dans les marais.
Le 9 septembre, Joffre décide d’une nouvelle contre-attaque au nord de Meaux sur l’Ourcq. Il effectue une trouée de cinquante kilomètres dans les lignes ennemies, ce qui permet à la Veme armée et au Corps expéditionnaire britannique d’attaquer les armées Allemandes exposées sur leur flanc en pleine manœuvre, les stoppant et les obligeant au repli sur la ligne Noyon-Verdun le long de l’Aisne.
Le 13 septembre, les Allemands établissent des positions défensives solidement implantées qui figeront le front. Certains diront « Ce fut une bataille gagnée mais une victoire perdue » car elle laisse les vainqueurs maîtres du terrain, mais elle ne peut infliger au vaincu ce sentiment d’infériorité sans espoir qui est la marque d’une défaite définitive. Cependant, la Marne représente la première victoire stratégique de la guerre, car, par leur succès, les Alliés rendent inéluctable pour l’Allemagne une guerre longue et couteuse sur deux fronts.
La contre-offensive de la Marne met en échec le plan Schlieffen, les lignes de défense constituées par les Allemands sur des points tactiquement favorables induisant dans un premier temps une stabilisation durable du front. Mais, dans un deuxième temps, les belligérants vont s’engager dans un épisode connu sous le nom de « course à la mer », chacun cherchant à contourner l’autre par l’ouest. Les attaques s’arrêtent sur le canal de l’Yser et devant Ypres. Ainsi, la guerre de mouvement devient guerre de position.
Sur le monument aux morts du cimetière de Villeneuve-la-Garenne, est inscrit le nom de Pierre Simon, soldat au 265eme régiment d’infanterie. Il est mort au combat à Buissoncourt, en Meurthe et Moselle le 8 septembre 1914. Il est l’un des quatre-vingt-mille tués de la bataille de la Marne.

Taxis de la Marne (ECPAD).
Thierry Gandolfo.

/image%2F1492507%2F20211019%2Fob_830480_nouveau-logo-sf.jpg)
/image%2F1492507%2F20211019%2Fob_1c3c28_img-6499.JPG)










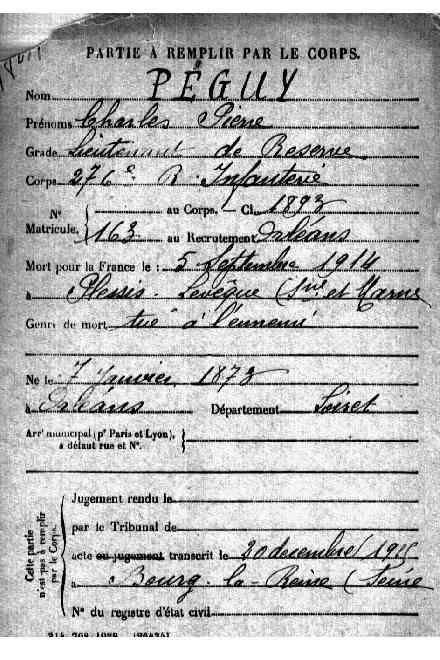
/image%2F1492507%2F20220328%2Fob_3c93c9_ph-18-soldats-portugais-au-front-p.jpg)